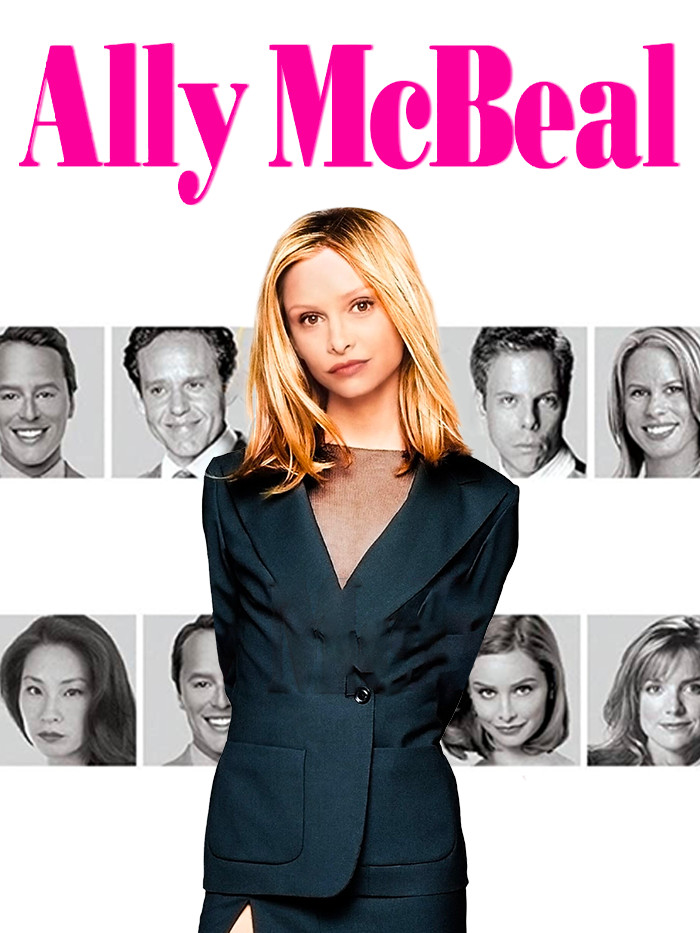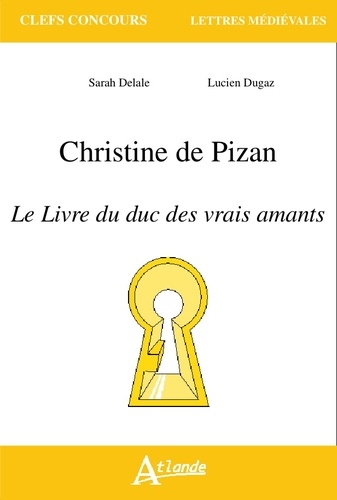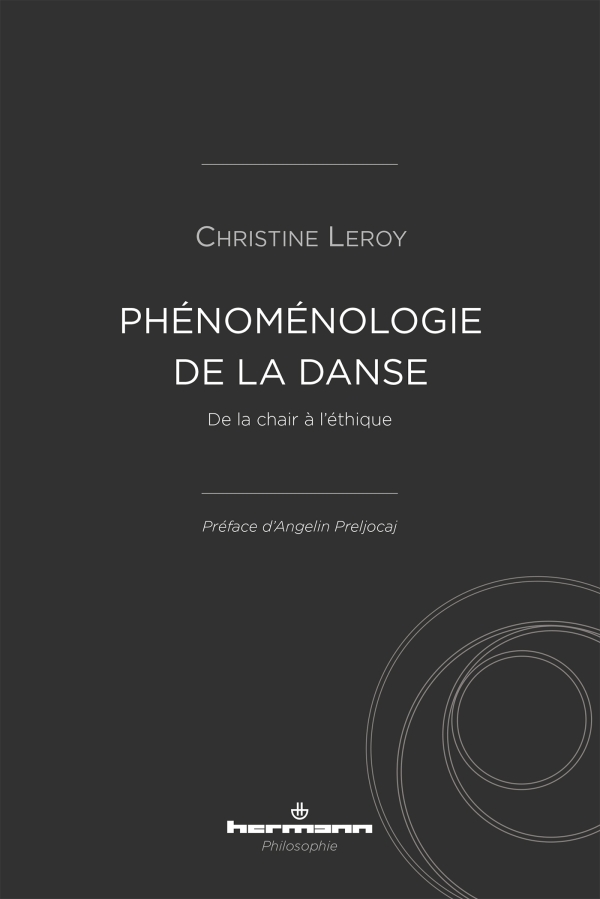Suite et fin de l’article de Sylvia Duverger sur l’écriture inclusive. Son interview est toujours en ligne sur le podcast Qui a peur du féminisme ?
À quand la fin de l’hégémonie linguistique du masculin ?
Il a été amplement montré qu’en matière de genre (féminin et masculin), l’évolution du français est politique.
Des grammairiens ont œuvré à ce que le français reflète l’organisation patriarcale de la société. Comme l’observait la linguiste Maria Candea dans un entretien que nous avons eu en 2014, ces grammairiens ont fait en sorte que les filles apprennent très vite, dès leur accès au langage, qu’elles étaient en toutes circonstances subordonnées aux hommes. C’est ce que signifie la règle « du masculin qui l’emporte sur le féminin », dont l’histoire, que nous rappellerons, ne laisse aucun doute à ce sujet.
L’exclusion du symbolique – de la langue, des représentations et de la culture –, exprime et conforte celle du politique et de l’économique.Affirmer que le masculin prend une valeur neutre, ou générique, et qu’il s’agit d’un genre « non marqué » ou « extensif » lorsqu’il prévaut sur le féminin dans une phrase où il cohabite avec lui ne relève pas de la grammaire en tant que telle et des règles qui sont nécessaires pour que nous puissions échanger, mais de l’idéologie phallocratique.Dire, comme nous verrons que le font des académiciens, que les titres désignant des fonctions prestigieuses (présidence, ministère, direction, rectorat…) ont vocation à demeurer au masculin même lorsque des femmes les exercent, c’est signifier que celles qui y accèdent sont des intruses dont il s’agit d’invisibiliser la présence; c’est enjoindre ces intruses à se masculiniser.
Les opposants à la féminisation des noms de métiers, des titres et des grades entreprise en France à partir de 1984 ne considèrent qu’il y a péril en la demeure que lorsqu’elle concerne des rôles socio-politiques jugés prestigieux : aux hommes, les responsabilités et aux femmes, les rôles subalternes.
La féminisation des noms de métiers vise à ce « que des femmes puissent être nommées dans leurs professions comme être social et pas seulement identifiées comme être familial, reproductrice, maman ou putain, “personnes du sexe”, fût-il le beau sexe avec une qualification glorifiante comme on disait “dame-pipi” ! Car l’histoire sociale a donné comme héritage aux femmes – perspective identificatoire – d’être avant tout une “pondeuse”, une reproductrice, un être du privé, du dedans », explique la linguiste Anne-Marie Houdedine, chargée en 1984 par Yvette Roudy d’œuvrer à ce que les femmes puissent se dire dans toutes leurs activités, des plus attendues (le care) aux plus éloignées des stéréotypes de genre (le pouvoir).
C’est bien en effet parce que la féminisation des noms de métiers et des titres visibilise les apports des femmes à la société, et signifie la légitimité de la place qu’elles ont prise dans la vie publique, économique et culturelle, qu’elle a rencontré – et rencontre encore – une opposition qui peine à dissimuler la misogynie et le sexisme dont elle procède. Sexisme et misogynie que l’histoire de notre exclusion linguistique révèle en effet sans détour.
Quelques repères dans l’histoire de la (dé)masculinisation du français
Au commencement étaient les féminins
Quelques exemples
Sous l’ancien régime, les titres nobiliaires étaient sexués : duchesse, baronesse, emper(r)esse, emperière…
Le titre d’ambassadrice existait bel et bien et il était attribué à des femmes remplissant des fonctions diplomatiques, telle la maréchale de Guébriant qui accomplit une mission en Pologne au nom de Louis XIV. Au XVIIIe, le mot a encore ce sens, mais depuis le XVIIe, il est concurrencé par celui d’« épouse d’ambassadeur », auquel il se réduit au XIXe siècle.
On rencontre au moins une inventeure, une procurateure et une conducteure dans un écrit du XVe siècle ; ceux de phisicienne, cyrurgienne (qui avait le sens d’infirmière), de miresse (la médecin), médecine ou médecineuse… étaient usités.
Dans le domaine religieux, les femmes avaient de multiples responsabilités et leurs titres étaient au féminin : elles étaient abesse (sic), papesse, moynesse, clergeresse (ou clergesse, c’est-à-dire religieuse), prieuresse…
Les écrits mentionnent aussi des défenderesses, des demanderesses, des jugesses, des possesseuses… et mêmes des prud’femmes.
Rappelons également qu’il y avait des doctoresses (entendez par là des femmes lettrées, des femmes savantes, puis, au XIXe ce terme désigne les premières médecins, ou « médecines »). Et bien sûr des autrices (ou auctrix, auctrice, authrice), comme l’a montré Aurore Evain. Autoresse, authoresse, auteuresse ont également existé. Ainsi que professeuses, amatrices, inventrices et capitainesses, successrices (sic) et vainqueresses, parmi tant d’autres.
La faute aux clercs… et à Molière
« De nombreuses études ont montré que, jusqu’au XVIe siècle, la langue avait des formes féminines correspondant à des formes masculines pour pratiquement tous les termes servant à désigner des métiers, titres, grades et fonctions, car du haut en bas de l’échelle sociale, les femmes étaient présentes et leurs activités énoncées par des termes qui rendaient compte de leur sexe. […]. Le XVIIe siècle centralisateur et dominé par l’image éminemment virile du “Roi soleil” ignorera superbement les termes féminisés, ou lorsqu’il les emploiera, ce sera avec condescendance ou ironie (c’est le cas pour “peintresse”). » En Europe, jusqu’au développement des États, les femmes pouvaient accéder à des fonctions dotées d’un pouvoir politique, judiciaire ou militaire. Bien qu’elles ne s’y adonnaient que dans une moindre mesure que les hommes, les clercs – les hommes diplômés dans leur ensemble – menèrent une offensive contre elles, afin de conserver leur mainmise sur les charges, les emplois que leur passage par l’université leur ouvrait. En premier lieu, ils ont privé d’instruction (a fortiori d’université) celles qui sinon auraient pu rivaliser avec eux ; et discrédité autant qu’ils le pouvaient les obstinées, devenues savantes et compétentes malgré les obstacles mis à leurs progrès. Ils firent tant et si bien que, par exemple, l’ambassadrice épouse de l’ambassadeur eut raison de l’ambassadrice en mission diplomatique, et que l’on oublia l’autrice pour ne plus songer qu’à la muse …
Créée en 1635 par Richelieu, l’Académie française a porté la cause du masculin-qui-l’emporte-sur-le-féminin jusqu’à aujourd’hui,comme nous le verrons. Il est vrai qu’elle n’a compté que des hommes jusqu’à l’élection de Marguerite Yourcenar en 1980 (seule parmi les 39 hommes au sein de la Compagnie). Elle n’a admis, en tout et pour tout, que dix femmes, qui toutes n’ont pas siégé en même temps : Marguerite Yourcenar (élue en 1980), Jacqueline de Romilly (en 1988), Hélène Carrère d’Encausse (en 1990), Florence Delay (en 2000), Assia Djebar (en 2005), Simone Veil (en 2008), Danièle Sallenave (en 2011), Dominique Bona (en 2013), Barbara Cassin (en 2018) et Chantal Thomas (en 2021).
À partir du XVIIe siècle, l’on constate une disparition progressive des féminins dès lors qu’il s’agit de professions dotées d’un certain prestige. Comme le dit fort bien Aurore Evain, « ce vide lexicographique était la marque d’une censure et la fabrique d’une exclusion ». À partir du XVIIe, le « féminin conjugal » passe de plus en plus fréquemment sous les fenêtres des grammairiens, sans qu’ils aboient : ces féminins relatifs et subalternes (épouse de l’ambassadeur, du maréchal, du président…) ne les froissent ni ne les alarment. Pas plus que dans les années 1980, ceux de la blanchisseuse, de la cuisinière ou de l’institutrice n’indisposeront les académiciens.
Peu à peu, entre le XVIIe et le XIXe, un nom de métier au féminin ne désigne plus que l’épouse de celui qui l’exerce. « Le féminin matrimonial est une remarquable image linguistique du statut de la femme, cantonnée à la sphère privée et à ses activités domestiques […], n’accédant au domaine public (masculin) que via son mari », conclut Bernard Cerquiglini.
La guerre menée par le sexe masculin contre le sexe féminin a comporté plusieurs fronts. Quand Molière œuvre à ridiculiser les Précieuses et les femmes savantes, il y apporte une contribution tout particulièrement efficace. Il plaide en faveur de l’ignorance et de l’hétéronomie des femmes, comme le fera plus tard Rousseau dans Émile ou de l’éducation. Émile, cependant,n’est pas aussi souvent étudié au collège, ni même au lycée, que ne le sont l’une ou l’autre des pièces misogynes du dramaturge préféré du Roi-Soleil. Et le rire assure une efficiente police du genre. Pour ma part, j’ai pris une assez claire conscience que j’étais féministe en classe de troisième, et plus Armande qu’Henriette, donc désapprouvée par Molière, et non conforme aux normes de genre encore en vigueur, puisque ma professeure de français semblait épouser le point de vue du dramaturge, bien qu’elle-même célibataire. Combien d’adolescentes Molière est-il parvenu à éloigner de l’étude et du savoir ?
Le siècle de Molière est celui d’une offensive contre l’emploi de désignations au féminin, nous l’avons vu, mais aussi contre l’accord égalitaire (l’accord de proximité), dont voici le récit.
Un masculin qui s’auto-anoblit
À la Renaissance, dans les écrits, le français supplante progressivement le latin ; or, en latin il y a un neutre, pas en français. Les grammairiens se contorsionnent pour faire valoir que les adjectifs féminins sont dérivés des masculins, comme Ève est, prétend-on, tirée de la côte d’Adam. Au XVIe siècle, « le dogme du masculin géniteur de féminin est bien implanté ». Au XIXe, Bescherelle laissera à penser que le substantif dénommant les personnes est masculin par nature, dont on dérive « son » féminin.
Au XVIIe, il s’agit de faire triompher le masculin du féminin quand ils se rencontrent dans une phrase. Vaugelas, ordonnateur du bel usage à la cour de Louis XIV et l’un des premiers académiciens, fait feu : « Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre deux féminins ».
Dans ses Doutes sur la langue française (1674), le jésuite Dominique Bouhours, affirme : « Quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte », et le plus noble, c’est le masculin, évidemment.
AuXVIIIe, le grammairien et encyclopédiste, Du Marsais confirme :« [le] masculin, [le] plus noble des deux genres compris dans l’espèce ».
L’accord de proximité
L’usage a résisté à la prééminence du masculin dans les accords, jusqu’à ce que l’école républicaine, née au XIXe, impose la règle du masculin qui l’emporte sur le féminin. Oubliée tout à fait la règle de proximité, selon laquelle l’adjectif et le participe passé s’accordent avec le genre (et le nombre) du substantif le plus proche. Au XVIIe, quand le poète François de Malherbe, au nom de la pureté du français, désapprouve, dans l’œuvre du poète Philippe Desportes, l’accord au féminin d’une série de substantifs commençant par des masculins et s’achevant par des féminins, Vaugelas, en revanche, préfère l’euphonie de l’accord de proximité dans « le cœur et la bouche ouverte à vos louanges » .
Notons que l’on accordait également le participe présent : « une couturière demeurante rue Saint-Sauveur ». Et que les pronoms n’avaient pas encore perdu leurs féminins lorsqu’ils se substituaient à un adjectif qui aurait dû être au féminin : « J’étais née, moi encore, pour être sage et je la suis devenue » (Le Mariage de Figaro). Au XVIIe, le grammairien Gilles Ménage reprend l’épistolière Mme de Sévigné parce qu’elle lui répond « je la suis aussi » (enrhumée) lorsqu’il lui dit qu’il est enrhumé : « Il me semble, Madame, que selon les règles de notre langue, il faudrait dire : Je le suis. Vous direz comme il vous plaira, ajouta-t-elle, mais pour moi je croirais avoir de la barbe si je disais autrement. »
Exclusion des femmes du politique et de l’écriture
En 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen… n’inclut pas les femmes ; celle de 1948 le fera… mais en anglais, pas en français !
En 1792, la requête des dames déposée à l’Assemblée nationale souligne la dimension politique de la subalternisation symbolique du féminin : « Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles » (on trouve ce texte sur Gallica). Cette requête, d’une modernité saisissante, a-t-elle été rédigée par des femmes ou faut-il la tenir pour une parodie, et se montrer soupçonneuse, comme l’historienne Paule-Marie Duhet devant certains cahiers de doléances attribués à des femmes ? La tendance désormais est à leur accorder du crédit autant que de la pertinence, suivant en cela l’ami de Michelet, Charles-Louis Chassin, qui estime que le contenu de ces écrits atteste d’un « mouvement féminin » actif durant toute la révolution, et Christine Fauré, qui abonde dans son sens.
1801 Sylvain Maréchal républicain révolutionnaire, journaliste et écrivain, est l’auteur d’un Projet de loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes. L’article 4 de ce texte précise que « la raison ne veut pas plus que lalangue française qu’une femme soit auteur. Ce titre, sous toutes ses acceptions, est le propre de l’homme seul. » « La raison veut que chaque sexe soit à sa place et s’y tienne »… et la place d’une femme est à la maison : « Une femme qui remplit fidèlement ses devoirs d’épouse et de mère est une véritable divinité, et l’accomplissement de ses devoirs ne peut être compatible avec le goût des sciences et des lettres. »
Cet écrit de Sylvain Maréchal, qui a tenté de se faire passer pour une plaisanterie, a tout de même été réédité deux fois après sa mort, augmenté de citations d’autres auteurs, observe Geneviève Fraisse.
Au XIXe siècle, une guerre est menée contre les bas-bleus. À la fin de ce siècle, de nouveau des femmes menacent le pré carré des clercs : elles franchissent les obstacles disposés le long de leur chemin, (re)deviennent doctoresse, chirurgienne, avocate, ingénieure, professeure (ou professeuse)… d’abord sans pouvoir se désigner comme telles.
Le féminin visibilise les femmes
En 1891, la romancière féministe, fouriériste, socialiste, pacifiste Marie-Louise Gagneur adresse à l’Académie française une pétition réclamant la féminisation des noms de métiers, titres et fonctions qui devenaient « coutumiers à la femme ». Lue en séance le 23 juillet, sa requête reçoit un accueil défavorable de la part des Immortels. S’ensuivent des échanges d’arguments par voie de presse. L’académicien Charles de Mazade lui répond que « la carrière d’écrivain n’est pas celle de la femme » ; il n’est donc pas besoin du mot écrivaine. Autrement dit, il admet que le genre du mot légitime l’exercice d’une fonction par les uns à l’exclusion des autres… ce que nieront catégoriquement les académiciens du XXe siècle, en particulier Lévi-Strauss et Georges Dumézil puis Marc Fumaroli.
1898 Hubertine Auclert, journaliste, écrivaine, féministe (suffragiste, notamment) voudrait qu’une académie féministe ait autant ses mots à dire que l’Académie française : « L’omission du féminin dans le dictionnaire contribue, plus qu’on le croit, à l’omission du féminin dans le code (côté des droits). L’émancipation par le langage ne doit pas être dédaignée. […] La féminisation de la langue est urgente, puisque, pour exprimer la qualité que quelques droits conquis donnent à la femme, il n’y a pas de mots. Ainsi, dans cette dernière législature, la femme a été admise à être témoin au civil, électeur, pour la nomination des tribunaux de commerce, elle va pouvoir être avocat. Eh bien ! on ne sait pas si l’on doit dire : une témoin ? une électeure ou une électrice ? une avocat ou une avocate ?
L’Académie féministe trancherait ces difficultés. Dans ses séances très suivies et où l’on ne s’ennuierait pas, des normaliens […] pourraient, en féminisant des mots, devenir féministes. En mettant au point la langue, on rectifierait les usages, dans le sens de l’égalité des deux sexes. »
Dans ses discours, De Gaulle s’adressait aux Françaises et aux Français, ce qui était admettre que les uns ne représentent pas les autres. Certains académiciens sont un peu plus qu’agacés par ces adresses paritaires, tel Jean Dutourd. On notera que le slogan de Macron, lors des dernières élections présidentielles, c’était en revanche « Nous tous »… soufflé par Jean-Michel Blanquer, son alors encore ministre de l’Éducation nationale et fervent adorateur du « masculin générique » ?
Sage-femme et maïeuticien ne sont pas dans le même bateau
1982 La profession de sage-femme s’ouvre aux hommes conformément à une directive européenne.
Trente ans plus tard, Yvette Roudy se souvient : « Quand on a ouvert le métier de sage-femme aux hommes, ils ont voulu une nouvelle appellation : maïeuticien. Pour les hommes, il fallait un terme compliqué et scientifique. »
En 1982, trois hommes deviennent sages-femmes et au moins l’un d’entre eux se réjouit d’être qualifié de tel . Le terme de sage-femme est épicène puisqu’il désigne la ou le sage qui met son savoir et ses compétences (sage) au service de la femme qui accouche ; la ou le sage-femme est donc en quelque sorte une ou un aide-parturiente.
Pourtant, l’Académie se trouve chargée de forger une dénomination conforme au genre de ces nouveaux praticiens. Par Pierre Mauroy, selon l’homme politique, écrivain et académicien Alain Peyrefitte.
Donner du masculin à une femme, serait-ce donc la hausser au rang de l’humain par excellence, tandis qu’un homme féminisé devrait se sentir humilié ? Médecin et académicien, le Pr Jean Bernard propose « maïeuticien ». Bien que ce terme ait été forgé par le philosophe Socrate pour se désigner lui-même comme un accoucheur, non pas de corps féminins, mais d’esprits masculins, fonction bien plus proche du vrai, du beau et du bien que celle de la simple sage-femme, comme l’était sa mère… En juin 1984,estimant que l’emploi du terme de « sage-femme » pour désigner un homme serait « ridicule », Alain Peyrefitte relaie dans les colonnes du Figaro la trouvaille de son illustre confrère.
Anecdote savoureuse : dans le cadre d’enquêtes linguistiques, Anne-Marie Houdebine a observé que le terme « maïeuticien » n’était pas compris par les locutrices et locuteurs interrogé·es; qu’il était quelquefois rattaché à l’emmaillotage et qu’à la place de « maïeuticien », certain.es entendaient « mailloticien » (construit sur le maillot dont autrefois on entourait le corps des marmots).
« Maïeuticien » fait son entrée dans les dictionnaires, mais il prend si peu que lors de la séance du 11 février 2009, le médecin et sénateur de gauche François Autain s’indigne : « Il serait […] temps de songer au remplacement du terme “sage-femme” par une appellation qui tienne compte du fait que cette profession est exercée par de plus en plus d’hommes. Le terme de maïeuticien, reconnu par l’Académie française, me semblerait particulièrement bien adapté. » Dès lors que des hommes exercent un métier, faudrait-il donc ne plus le dire qu’au masculin ? Même si les femmes y demeurent très largement majoritaires (1 à 2 % d’hommes sages-femmes…) ?
Il semble que cette préconisation ait fini par être suivie de quelque effet, et l’on trouve désormais dans des textes plus ou moins institutionnels cet étrange couple : « maïeuticien ou sage-femme » , sage-femme ou maïeuticien , le pire étant : « maïeuticien (sage-femme) »…
Il y a, cependant, des sages-femmes heureux de l’être. L’un de ces heureux accoucheurs dit en outre que « maïeuticien » ne rend pas justice à l’amplitude de ses responsabilités, contrairement à « sage-femme ». Le constat est fait que le terme de « maïeuticien » n’est ni utilisé ni compris . Voilà des sages-femmes bien plus éclairés que les Immortels ! En effet, comme l’observe Claudie Baudino : « Vent debout contre les femmes qui réclameront en 1984 la féminisation des usages, l’Institution s’est réunie pour débattre de la désignation d’un seul homme. […] Au mépris des usagers, l’Académie a fait le choix de la distinction, sociale et masculine. »
Raphaël Haddad, docteur en communication, qui est à l’origine du Manuel d’écriture inclusive publié en 2016 (voir plus loin) analyse cet épisode dans une note de blog : « “Sage-femme” constitue […] un bel exemple si l’on veut démontrer combien l’inconfort dans les mots entraîne un inconfort social. » Inconfort social dont les locutrices font précisément l’expérience lorsqu’elles sont dites au masculin sans que les académiciens s’en émeuvent, au moins jusqu’à ce qu’ils comptent dans leurs rangs des femmes qui entreprennent de leur déboucher les oreilles.
1984-1986 : la féminisation des titres et noms de métiers
1984-1986 Yvette Roudy, alors ministre des droits de la femme (sic), charge Benoîte Groult de présider une commission de terminologie afin de féminiser les titres, les noms de métiers et de fonctions pour que les femmes se sentent légitiment à exercer tous les emplois. A ses côtés, Anne-Marie Houdebine, chargée de la direction linguiste de cette commission, dont les travaux conduiront à la circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
Dans un entretien de juin 1984, Yvette Roudy rappelle qu’elle s’est elle-même employée, dès sa nomination, à ce que le féminin cesse d’être jugé inapte à dire les plus hautes fonctions : « Mon propre décret d’attribution m’appelait “madame le ministre”. Quand j’ai lu – parlant de moi – “il pourra… ”, j’ai dit non. Il existe des limites à ne pas dépasser. Je n’ai tout de même pas changé de sexe en accédant à un poste prévu pour les hommes ! Je suis obligée de corriger régulièrement le compte rendu de mes interventions au Parlement pour qu’on y utilise le pronom “elle ” […] Comment expliquez-vous que seules les professions d’exécution puissent être féminisées ? Lorsqu’on a ouvert aux hommes l’emploi de sage-femme, on leur a donné du “maïeuticien”. En revanche, on continue sans sourciller à appeler les femmes des “prud’hommes”.».
Les linguistes québécoises ont été pionnières en matière de démasculinisation du français. Le 8 mars 1983, à Beaubourg, Anne-Marie Houdebine évoque leurs recommandations lors d’une conférence à laquelle Yvette Roudy assiste. Elle souligne l’intérêt du recours aux noms de métiers et aux titres au féminin pour faire apparaître les femmes comme actrices sociales. Or Yvette Roudy tient tout particulièrement à ce que sa loi du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle soit suivie d’effets : il faut lever les obstacles symboliques à la parité économique ; les offres d’emploi doivent donc comporter les deux genres, féminin tout autant que masculin. La ministre des Droits de la femme vient de trouver la linguiste qui va lui permettre d’œuvrer en ce sens.
Extrait de l’entretien réalisé en 2016 avec A.-M. Houdebine à ce sujet : « À cause de la loi “dite Roudy” sur l’égalité professionnelle, la ministre nous a dit qu’elle était “accablée” de demandes des divers ministères la questionnant à propos des noms de métiers à proposer aux annonceurs (une majorité d’hommes généralement) qui les questionnaient. Ils ne trouvaient pas les mots. Preuve s’il en est que les Français·es sont insécurisé·es dans leur langue : elles/ils ne la savent pas. Elles/ils la croient existant seulement dans LE dictionnaire. Comme s’il n’en existait qu’un qui dise la langue, quand ce sont ses sujets parlants qui la font exister ! Mais, apparemment, ni les employés des ministères (des hommes pour la plupart dans les années 1980), ni les annonceurs, ni les publicitaires, qui pourtant n’hésitent pas à créer des néologismes, ne connaissent réellement la langue. À moins qu’il ne faille évoquer une causalité, plus politique, plus idéologique : la nomination des femmes est le cadet de leurs préoccupations. Et même, le fait qu’elles ne soient pas nommées comme actrice(s) sociale(s) ne les gêne aucunement. Comme disait Lacan, “la femme n’existe pas”, ce qui fait entendre ce sexisme : d’une femme, ce que la socialité attend, voire chacun, c’est la mère, l’épouse et la mère, mais une femme… de plus actrice sociale, c’est une tout autre affaire ! »
Telle est bien en effet la fin que poursuivirent sous les augustes voûtes de l’Institut de France, quai Conti, les hommes qui déblatèrent en habit vert contre le féminin, ce genre « marqué » dont la « spécificité » serait contraire à l’universel des fonctions sociales : masquer sous un masculin de façade l’importance croissante des contributions féminines. Ainsi, observe malicieusement Benoîte Groult, les recommandations de l’Académie française en juin 1984 sont-elles de « continuer à dire un écrivain-femme, une femme-avocat, une femme-juge, un peu comme on dit un apprenti sorcier pour expliquer qu’il ne s’agit pas tout à fait d’un sorcier. Contentons-nous d’avoir obtenu de mettre secrétaire au féminin, (au XIXe siècle) toutes les fois qu’il s’agit de servir un patron, mais au masculin quand c’est la France qu’on prétend servir. Ne nous reste-t-il pas lingère, blanchisseuse, manucure, hôtesse de l’air (non, pas pilote, voyons ! pan sur les doigts…), concierge, infirmière, cuisinière et tant d’autres beaux métiers féminins ! »
Cachez ce féminin que les académiciens ne sauraient voir !
Il convient de souligner que la commission, bien que mixte et très légalement constituée, fut aussitôt l’objet d’attaques qui méritent de rester dans les annales du sexisme débridé. Elle comportait pourtant des linguistes renommé·es et fondait ses propositions sur des enquêtes menées conformément à la méthodologie scientifique. Près de quarante ans ont passé sous le pont Neuf et le pont des Arts, et l’Académie a tellement honte du sexisme et de la misogynie évidentes de sa déclaration de 1984 qu’elle l’a supprimée de son site. « Ce ne sont plus le positions de l’Académie », m’a répondu, en substance et en guise d’explication, la personne chargée de la communication de la « vieille dame du quai Conti ».
À partir de 1984 et vingt années durant, la Compagnie fera obstacle à la féminisation des noms de métiers et des titres. Il faudra attendre 1998 et 2005 pour que, respectivement, Le Monde et Le Figaro adoptent le féminin pour les titres politiques.
Les académiciens affirment que le genre grammatical et le sexe n’ont rien à voir ; ils tiennent pour une question subsidiaire que les noms désignant des êtres sexués, en particulier les êtres humains et les animaux qui leur importe, soient grammaticalement genrés conformément à leur sexe (apparent, social ou biologique). Ils omettent l’évidence : dans les noms de métiers, le masculin renvoie aux hommes (boulanger), et le féminin aux femmes (boulangère) ; leurs tribunes, publiées pour la plupart dans Le Figaro, regorgent de sous-entendus ou d’allusions sexuelles, attestant de leur inaptitude à considérer les femmes autrement que comme des objets sexuels – on comprend, dans ces conditions, qu’Hélène Carrère d’Encausse tienne à se mettre à l’abri du masculin pour exercer ses fonctions de « secrétaire perpétuel » de l’Académie française… L’entretien dans lequel le très distingué Georges Dumézil feint de croire qu’il faudra dire « la recteuse » ou « la rectoresse », parce que « la rectrice » désignerait de toute éternité la femme du recteur, et où il finit par louer les mérites de « l’admirable substantif “conne” », juste après avoir évoqué Benoîte Groult, est à cet égard des plus révélateurs de l’effet de panique que produisent sur les clercs des femmes qui prennent la liberté de féminiser leurs titres, s’autodésignent et se visibilisent en tant que citoyennes actives, portant ainsi un nouveau coup à l’hégémonie masculine. Exit Adam et son pouvoir exclusif de nomination ! tel est en effet ce que signifie la démasculinisation de la langue française.
C’est cette panique académique, les sophismes qu’elle inspire que nous avons analysées dans L’Académie contre la langue française. Ouvrage très sérieux et pourtant franchement comique, tant ces académiciens qui ne sauraient voir de féminins se transforment en Trissotins, tenaillés qu’ils sont par un inconscient misogyne et de quasi-délires érotico-grammaticaux.