[photopress:arton2047.jpg,thumb,pp_image]Donc le genre n’est pas donné d’avance…
Comme cela, cela n’a pas l’air si grave. Ça sonne comme un bon argument contre ceux qui nous saoulent avec l’intuition féminine, Mars et Vénus et les histoires de cartes routières…Rien n’est typiquement féminin ou masculin, le genre n’est pas donné d’avance.
Pourtant on doit tous trouver notre genre (qu’ils correspondent ou non à notre sexe, ça c’est une autre histoire, on a compris).
Mais qu’est ce que c’est le genre ? Comment on fait pour trouver son genre ?
Le genre, ce n’est rien, ce n’est pas une substance. Le genre est performatif : « il constitue l’identité qu’il est censé être » p.96. Censé parce qu’on n’a pas de modèles, de définition, de normes…
Donc on fait tous comme le drag : on parodie ce que l’on croit représenter un genre. « L’idée que je soutiens ici, à savoir que le genre est une parodie, ne présuppose pas l’existence d’un original qui serait imité par de telles identités parodiques. Au fond, la parodie porte sur l’idée même d’original » p. 261. → définition du genre « Le genre consiste davantage en une identité tissée avec le temps par des fils ténus, posée dans un espace extérieur par une répétition stylisée d’actes »
Mais là où j’aime bien Butler, parce qu’elle va jusqu’au bout de son idée mais sans tomber dans l’extrémisme… Certes, il y a un poids sur l’individu car il doit imiter un original qui n’existe pas… « Le genre est aussi une norme que l’on ne parvient jamais entièrement à intérioriser ; l’ « intérieur » est une signification de surface et les normes de genre sont au bout du compte fantasmatiques, impossibles à incarner. »p. 265. Mais cette situation serait purement absurde, si Butler n’introduisait pas une dimension sociale : tout le monde y croit, y compris les acteurs. C’est une idée, tout à fait wittgensteinienne à mon sens, qui évite de remonter à l’infini la chaîne des pourquoi : à partir du moment où tout le monde comprend, ça suffit.
Parce que l’objectif de Butler est d’abord la tolérance (voir post suivant)
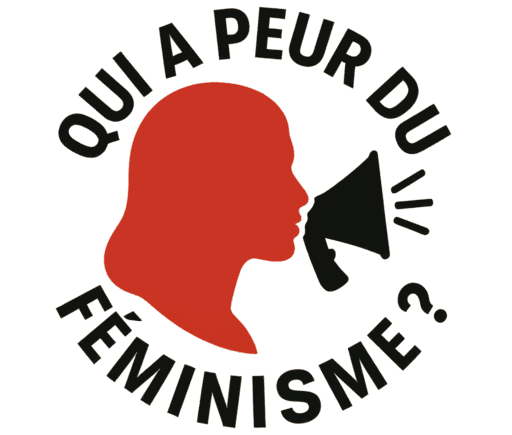
 Elizabeth Barrett naît en 1806 à Durham en Angleterre. Quatre éléments se détachent de sa biographie : une précocité intellectuelle, une maladie incurable, un père autoritaire et une passion amoureuse.
Elizabeth Barrett naît en 1806 à Durham en Angleterre. Quatre éléments se détachent de sa biographie : une précocité intellectuelle, une maladie incurable, un père autoritaire et une passion amoureuse.