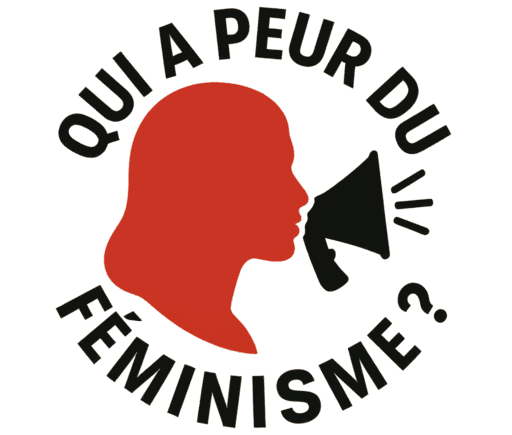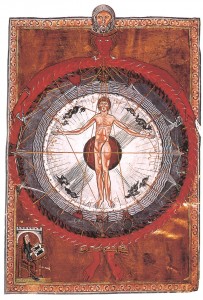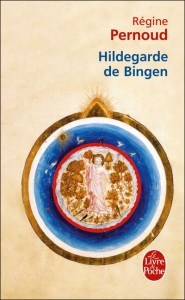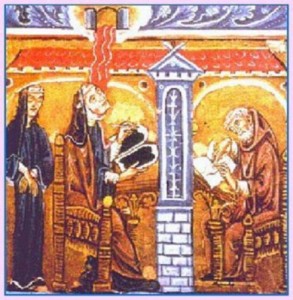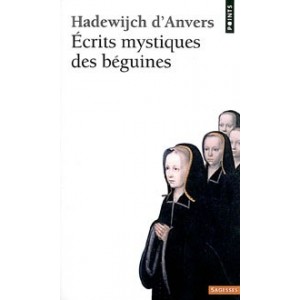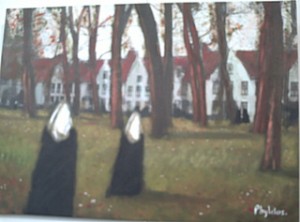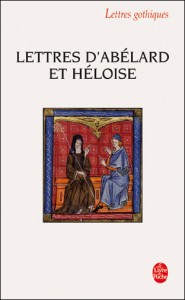 George Duby met en cause l’authenticité des Lettres de deux manières :
George Duby met en cause l’authenticité des Lettres de deux manières :
Premièrement c’est une œuvre construite. A cette époque la correspondance n’était pas un exercice spontané et informel, les épistoliers avaient un projet. Ce ne sont pas des confidences, comme on a parfois voulu le faire croire. Ensuite, et c’est à mon avis le plus intéressant, il doute qu’Héloïse soit l’auteure des lettres qui lui soient attribuées. Héloise, comme d’autres figures féminine du Moyen-Age, lui semble instrument de l’Eglise et des hommes pour vanter le mariage et le célibat, les moyens de maîtriser les femmes, dangereuses créatures qui vivent le désir (p 125 dans l’édition Folio de Dames du XIIème). En effet, les lettres présentent la femme comme timide et indocile et font l’éloge du mariage, même si au départ Héloïse semble se rebeller. Dans la littérature postérieure, c’est cet aspect qui a été retenu. Héloïse est la « championne du libre-amour » (p.86) qui refuse le mariage, la rebelle. « La précoce héroïne d’une libération de la femme ».