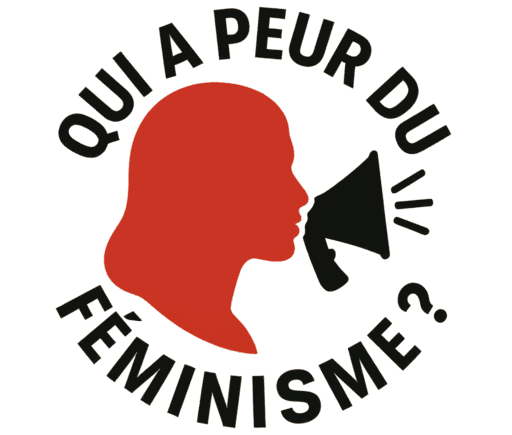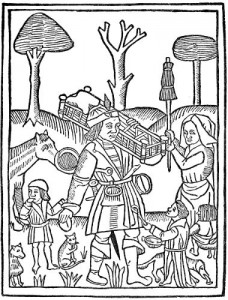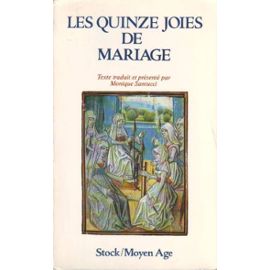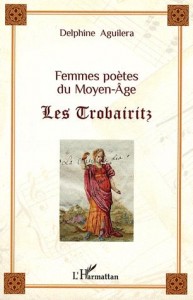Les Evangiles des Quenouilles se présentent sous forme de veillées pendant lesquelles 6 femmes discutent et échangent des croyances ayant trait aux sentiments amoureux, à la conception d’un enfant, à la santé. Il s’agit de superstitions populaires dont la lecture peut étonner d’abord et ennuyer ensuite ; à la relecture, l’ironie est partout présente, et c’est ce qui rend ce texte intéressant. Les croyances énoncées semblent parfois être prises au pied de la lettre… puis la glose qui les suit, c’est-à-dire le commentaire qu’en fait une auditrice, peut rendre la croyance absurde. On ne sait plus quoi croire…
Les Evangiles des Quenouilles se présentent sous forme de veillées pendant lesquelles 6 femmes discutent et échangent des croyances ayant trait aux sentiments amoureux, à la conception d’un enfant, à la santé. Il s’agit de superstitions populaires dont la lecture peut étonner d’abord et ennuyer ensuite ; à la relecture, l’ironie est partout présente, et c’est ce qui rend ce texte intéressant. Les croyances énoncées semblent parfois être prises au pied de la lettre… puis la glose qui les suit, c’est-à-dire le commentaire qu’en fait une auditrice, peut rendre la croyance absurde. On ne sait plus quoi croire…
Il en va de même pour la vision des femmes qui se dégage de ce texte. Dans le prologue, l’auteur (masculin) dit vouloir glorifier les femmes « doctoresses » qui détiennent un tel savoir ; mais il les compare avec solennel aux évangélistes, comparaison et sérieux quelque peu exagérés. On comprend alors qu’on est du côté de l’ironie : ces femmes ne sont pas réellement des autorités pour un lettré. Mais on doute tout aussitôt : pourquoi, alors, prendre le soin de rapporter toutes ces croyances, si on n’y accorde pas de prix ? Est-ce pour se moquer de leur absurdité ? Le texte était en effet copié pour des aristocrates à côté de devinettes et de « jeux de société ». Pourtant, le Moyen Age n’est pas l’époque du rationalisme…. En témoignent les bestiaires, qui définissent par exemple le chat comme un animal qui sait tout du passé et de l’avenir mais qui refuse de rien en dire ! Alors quoi ? Ces femmes sont-elles vraiment considérées comme savantes ? Pourquoi alors faire suivre les croyances qu’elles exposent par des gloses les tournant en dérision ? Est-ce pour se défendre d’y croire tout à fait, tout en concédant la fascination qu’elles exercent ?
Par cette ambiguïté, ce texte me semble rendre bien l’ambivalence de la superstition : on dit qu’on n’y croit pas, on y fait tout de même attention malgré soi, au cas où… Plusieurs croyances développées ont par exemple trait à la conception des enfants et à l’influence de certaines pratiques sur son physique : chez Montaigne, le fait qu’une femme ait regardé le portrait d’un homme noir suffit à expliquer que l’enfant soit métisse ! Y avait-il de l’ironie chez Montaigne dans ce passage ? Ce n’est pas exclu ; il se ferait en cela le relais des Evangiles, dont l’ambivalence à l’égard de la superstition se retrouve à propos des femmes : objets de fascination et de dérision, elles portent avec elles le mystère du sentiment amoureux (certains hommes, dans la littérature, se sentent ensorcelés par une femme et subissent cet attrait comme un charme inexplicable) et de la vie.