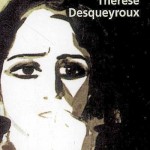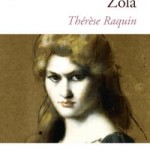L’article de Bettelheim, « Devenir femme », met le doigt sur la polysémie du terme « féminité » : il y a la féminité telle que la prescrit la société et par rapport à laquelle de nombreuses femmes cherchent à entrer en conformité, et la « féminité adulte », qui est tout autre chose et qui passe par la prise de conscience de ses aspirations.
Bettelheim relève une rupture dans la vie de la femme entre ce à quoi l’encourage la société pendant son enfance et son adolescence (rivaliser avec les garçons, faire de brillantes études) et ce à quoi elle la destine adulte (éléver des enfants, rester à la maison). Surqualifiée pour la place qu’on lui réserve, une frustration sourde la gagne et la ronge de l’intérieur.
Par ailleurs, l’ouvrage de Margaret Mead, Male and female, présente lui aussi plusieurs définitions de la féminité : dans son deuxième chapitre, elle présente 7 peuples du Pacifique et leur conception de la féminité, saisie par son rapport au corps. Mais, et c’est aussi ce qui est intéressant chez M. Mead, à chaque conception de la féminité correspond une conception de la virilité corollaire : on ne naît pas plus femme qu’homme, et chaque culture invente sa féminité et sa virilité.
Ce deuxième ouvrage traite également de la frustration féminine : « Chaque civilisation a mis au point, à sa manière, des institutions qui permettent aux hommes de trouver la certitude de leur virilité. Il est encore peu de civilisations qui aient trouvé le moyen de donner aux femmes l’inquiétude divine dont parle le poète et qui exige d’autres satisfactions que celles de la maternité » (p. 149).
Ce phénomène de frustration, nous l’avons vu à l’oeuvre dans plusieurs oeuvres littéraires, même s’il n’était pas toujours mis en relation avec un idéal d’excellence durant l’adolescence, au contraire (voir Thérèse Raquin, Thérèse Desqueyroux, Betty). Cette frustration est-elle un donné universel des destinées féminines ?
Non selon M. Mead, qui y voit un effet de la culture : « Le problème permanent de la civilisation est de définir le rôle de l’homme de façon satisfaisante (…) afin qu’il puisse, au cours de sa vie, parvenir au sentiment stable d’un accomplissement irréversible (…). Pour que les femmes atteignent à ce sentiment d’un accomplissement irréversible, il suffit que la société leur permette d’accomplir leur tâche biologique. Si elles sont inquiètes, si elles cherchent autre chose, lorsqu’elles sont mères, c’est l’effet de l’éducation. » (p. 148-149).
Selon Bettelheim, il faut élever les enfants dans l’idée que « les femmes ont beaucoup plus de choses en commun avec les hommes que notre société veut bien l’admettre », ceci dans le but suivant : « nos filles pourront accepter le mariage et la maternité comme une part importante de leur avenir, une part qui ne gâchera pas – par le désespoir, la résignation ou l’ennui – ce que leur vie et leurs potentialités ont de meilleur » (p. 298).
Dans les deux cas, la frustration est lue comme un donné anormal, inculqué par la civilisation (pacifique ou occidentale) : est-ce à dire que la vérité résiderait dans la maternité comme seul épanouissement, selon Mead comme Bettelheim ?
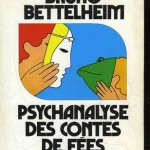 Le nom de Bettelheim est connu surtout pour sa Psychanalyse des contes de fées et pas pour cet article sur le « Devenir femme » ; pourtant, il me semble qu’on peut faire un lien entre les deux écrits, puisque le premier ouvrage traite de nombreuses héroïnes féminines et que les contes de fées mettent justement en scène et en question le devenir-femme : le petit chaperon rouge et les risques de la séduction, par exemple. La réflexion sur la féminité dans l’Amérique de l’après-guerre n’est sans doute pas pour rien dans l’analyse psychanalytique des contes de fées.
Le nom de Bettelheim est connu surtout pour sa Psychanalyse des contes de fées et pas pour cet article sur le « Devenir femme » ; pourtant, il me semble qu’on peut faire un lien entre les deux écrits, puisque le premier ouvrage traite de nombreuses héroïnes féminines et que les contes de fées mettent justement en scène et en question le devenir-femme : le petit chaperon rouge et les risques de la séduction, par exemple. La réflexion sur la féminité dans l’Amérique de l’après-guerre n’est sans doute pas pour rien dans l’analyse psychanalytique des contes de fées.