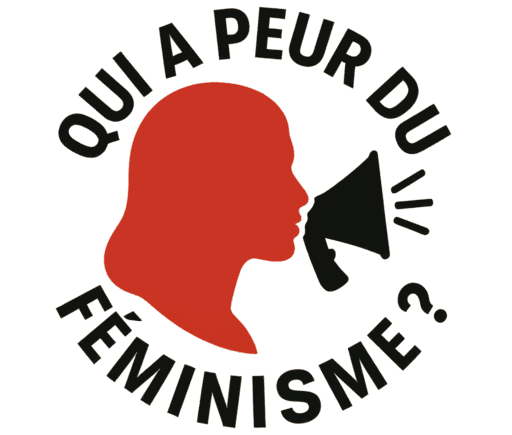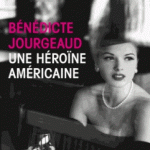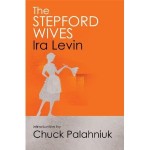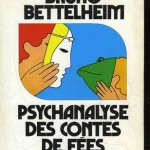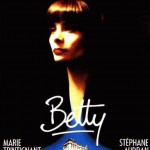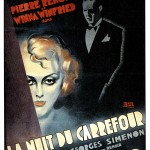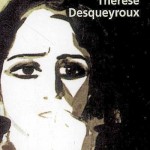On trouve dans To the Lighthouse une description d’anthologie de la maison en l’absence de ses habitants, qui fait écho à la disparition de la mère. Curieusement, on retrouve une description similaire dans un autre tome des Claudine, La maison de Claudine, qui s’ouvre sur la maison familiale présentée comme un décor de théâtre où se trouvent dissimulés les enfants que la mère, entrant sur la scène de la mémoire, appelle et cherche. Dans les deux cas, l’accent est mis sur le poids de l’habitude et sa révélation lorsque l’habitude est brisée : quelque chose est perdu, cette chose c’est la famille et son centre fondateur, la mère.
On trouve dans To the Lighthouse une description d’anthologie de la maison en l’absence de ses habitants, qui fait écho à la disparition de la mère. Curieusement, on retrouve une description similaire dans un autre tome des Claudine, La maison de Claudine, qui s’ouvre sur la maison familiale présentée comme un décor de théâtre où se trouvent dissimulés les enfants que la mère, entrant sur la scène de la mémoire, appelle et cherche. Dans les deux cas, l’accent est mis sur le poids de l’habitude et sa révélation lorsque l’habitude est brisée : quelque chose est perdu, cette chose c’est la famille et son centre fondateur, la mère.
De là à voir dans la maison le symbole de la mère, par quasi-métonymie, il n’y a qu’un pas ; et ceci d’autant plus que nous avons déjà rencontré l’idée de la femme « ange du foyer » dans nos lectures victoriennes.
Pourtant ce n’est pas avec La maison de Claudine mais avec Claudine s’en va que nous avons voulu nouer un dialogue des deux côtés de la Manche. Dans cet autre volet des Claudine, on trouve la mention d’une maison familiale au début, trop tôt quittée par la jeune mariée Annie. La maison dans laquelle elle s’installe avec son mari n’a rien du symbole familial de To the Lighthouse ou de La maison de Claudine, et pour cause : aucune famille n’est vouée à s’y installer, le couple que forment Annie et son mari n’étant pas viable. En fait d’enfant, Annie pourrait tenir le rôle, tant son mari l’infantilise. Dès lors c’est en fuyant cette maison qui n’est pas la sienne qu’Annie s’émancipe du rôle de femme-enfant que son mariage entendait lui faire jouer. – En ce sens, la métaphore de la femme-maison peut fonctionner dans les deux romans, mais pas de la même manière.