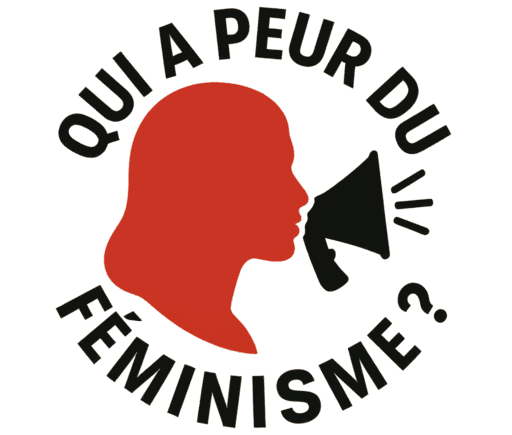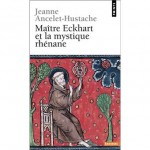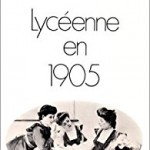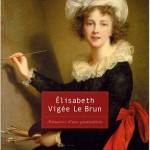Nous avons vu avec Artemisia Gentileschi que l’ombre du père planait sur sa carrière et sur sa reconnaissance, encore aujourd’hui, en tant qu’artiste peintre. Le même phénomène s’observe à propos de Camille Claudel, à laquelle la biographe au programme de notre club ce mois-ci est venue par la connaissance de l’oeuvre de son frère, Paul Claudel. Anne Delbée est en effet une femme de théâtre (elle-même préférant le terme « homme de théâtre »), fille de Jean-Louis Barrault, qui a ressenti sa vocation théâtrale lors d’une représentation d’une pièce de Paul Claudel.
Nous avons vu avec Artemisia Gentileschi que l’ombre du père planait sur sa carrière et sur sa reconnaissance, encore aujourd’hui, en tant qu’artiste peintre. Le même phénomène s’observe à propos de Camille Claudel, à laquelle la biographe au programme de notre club ce mois-ci est venue par la connaissance de l’oeuvre de son frère, Paul Claudel. Anne Delbée est en effet une femme de théâtre (elle-même préférant le terme « homme de théâtre »), fille de Jean-Louis Barrault, qui a ressenti sa vocation théâtrale lors d’une représentation d’une pièce de Paul Claudel.
Les relations du frère et de la soeur sont abordés dans l’ouvrage ; mais la figure masculine la plus importante pour Camille Claudel, c’est celle de Rodin, qui à la fois catalyse, cristallise et vampirise le talent de Camille. Là où le frère est une figure masculine positive, que la postérité aura davantage mieux en avant que sa soeur, le maître Rodin est un danger pour la femme artiste, mis en position de prédateur. Les relations de concurrence propres au champ artistique prennent alors un tour de séduction potentiellement perverse.
Comment penser sereinement les rapports hommes/femmes dans un contexte concurrentiel ? J’ai l’impression que notre examen des écrivains femmes a certes relevé des rapports de ce type mais que la dimension de prédation de la part des rivaux masculins n’était pas si forte : qu’en penses-tu ?