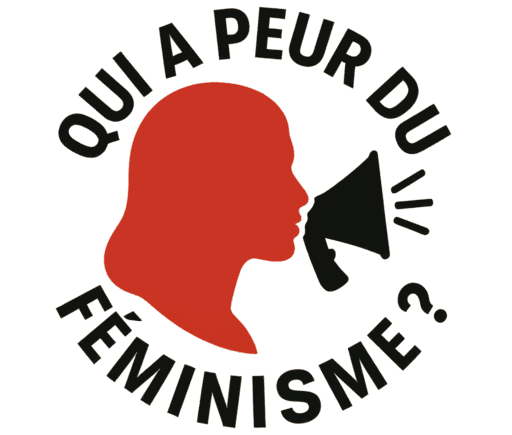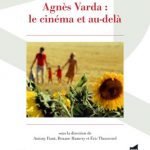Selon Françoise Giroud, Alma Mahler aurait été une artiste contrariée qui aurait trouvé dans ses mariages avec de grands artistes des compensations à sa vocation frustrée.
Selon Françoise Giroud, Alma Mahler aurait été une artiste contrariée qui aurait trouvé dans ses mariages avec de grands artistes des compensations à sa vocation frustrée.
Selon Catherine Sauvat, cette vision est partisane et exagérée, un peu trop romanesque pour être vraie, et correspondait plutôt à une vision d’elle-même qu’aurait favorisée Alma Mahler elle-même.
Qu’en penser en définitive ? C’est un fait que lorsqu’elle aurait pu exprimer ses dons artistiques, Alma Mahler ne l’a pas fait : on ne peut pas vraiment parler de frustration ou de contrariété. Est-ce pour autant une simple courtisane imbue d’elle-même ? La question est difficile à trancher.
Peut-être correspond-t-elle à une catégorie que nous n’avions pas envisagé auparavant : celle de la « femme d’artiste », qui assume à la fois la vie mondaine attachée à certaines carrières artistiques et évolue depuis toujours dans les cercles concernés.