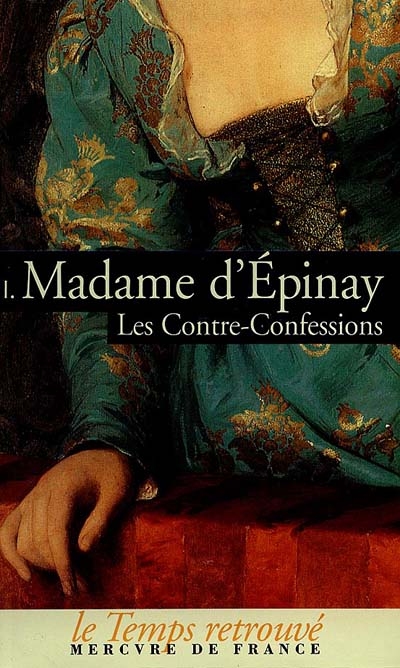[photopress:In_a_different_voice.jpg,thumb,pp_image]En préambule, je relève la définition de l’éthique du « care » donnée par C. Gilligan : This relationnal ethic transcends the age-old opposition between selfishness and selflessness, which have been the staples of moral discourse. (…) Relationship requires a kind of courage and emotional stamina which has long been a strength of women, insufficiently noted and valued (p. XIX).
L’ouvrage de Carol Gilligan exhibe, à travers une série d’entretiens psychologiques, de quelles différentes manières hommes et femmes abordent et traitent les mêmes problèmes moraux. Elle met en avant la préoccupation féminine de « ne pas heurter » autrui, de ne pas faire de mal, quand les hommes auraient tendance à envisager les conflits moraux de manière plus rationnelle, plus logique, plus abstraite (je pense ici aux réponses des deux enfants au dilemme de Heinz : un homme dont la femme va mourir si elle ne reçoit pas un médicament pour lequel ils n’ont pas assez d’argent doit-il voler ce médicament au pharmacien?). L’éthique du care « rests on the premise of non violence – that no one should be hurt ». C’est de la compréhension de cette éthique particulière, de cette voix différente, propre aux femmes, que pourrait émerger une psychologie plus adaptée car plus attentive aux singularités de chaque genre. C’est aussi de cette compréhension que dépendrait une meilleure entente entre les sexes.