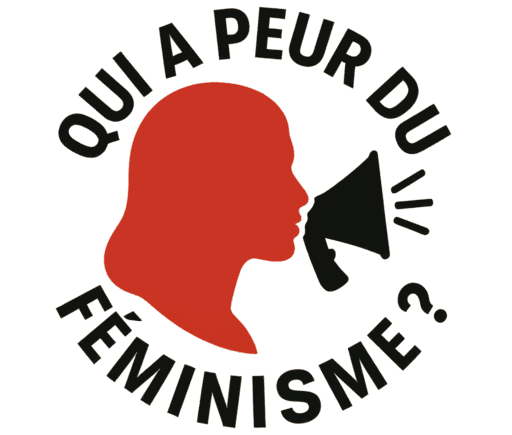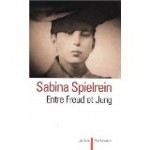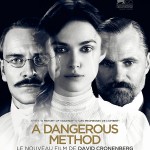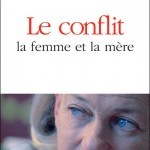 Si Badinter a intitulé son ouvrage Le Conflit. La femme et la mère, c’est, il me semble, parce que ce conflit n’est pas naturel mais culturel – c’est-à-dire : parce qu’il n’y a pas nécessairement de conflit entre être une mère et être une femme.
Si Badinter a intitulé son ouvrage Le Conflit. La femme et la mère, c’est, il me semble, parce que ce conflit n’est pas naturel mais culturel – c’est-à-dire : parce qu’il n’y a pas nécessairement de conflit entre être une mère et être une femme.
Selon les pays (Badinter compare les différents pays d’Europe, notamment la France et l’Allemagne), les politiques adoptés par leur gouvernement et les mentalités, le conflit n’est pas ressenti avec la même intensité partout. J’ai été marquée, par exemple, par l’écrasante adhésion à l’idéal de bonne mère, selon les études que cite Badinter, en Allemagne, qui pousse précisément les jeunes femmes les plus diplômées à ne pas avoir d’enfant. Que la France soit la championne des femmes assumant d’être de « mauvaises mères » m’a semblé plutôt sain et rassurant!
Et si pour accepter de devenir mère, il fallait accepter d’être toujours-déjà une mauvaise mère ? D’où de pardonner à ses propres parents de ne pas avoir été à la hauteur de notre demande infantile ? Accepter de devenir parent, n’est-ce pas, au fond, accepter de ne pas être parfait ? Ce que n’accepte apparemment pas Linda Lê dans À l’enfant que je n’aurai pas.
J’irai même un peu plus loin : l’idéal de la bonne mère est contradictoire avec le rôle réel d’une mère. L’idéal de la bonne mère définit la maternité comme une protection perpétuelle, un amour sans faille, avec un danger de fusion non négligeable. Le rôle réel d’une mère est de protéger, certes, d’aimer, certes, mais aussi de faire grandir et de laisser partir son enfant. Dès le départ, il s’agit de renoncer à ce rôle d’ « alpha et d’oméga », de mère-monde, que la mère idéale représente dans l’esprit d’un tout-petit. Être une mère, c’est accepter que notre enfant cesse un jour d’avoir besoin de nous ; c’est savoir ne pas avoir besoin de lui. Et pour cela, il faut savoir rester une femme.
Ne pas se réduire à n’être qu’une mère, voilà peut-être la manière dont résoudre le « conflit » entre mère et femme.