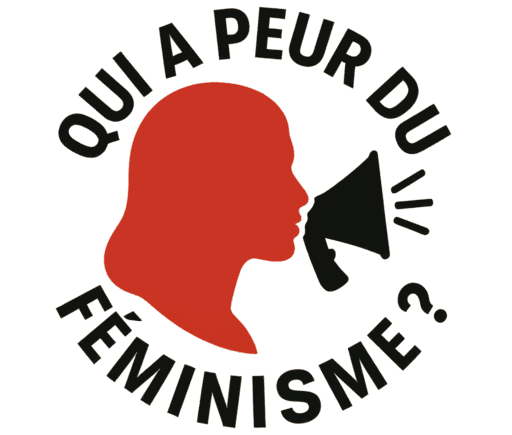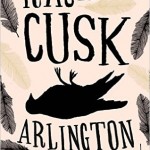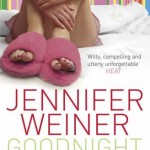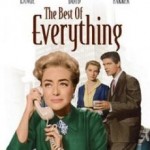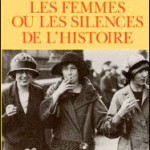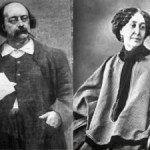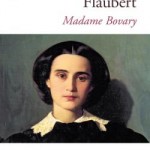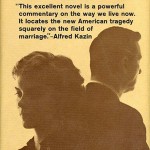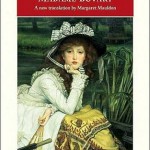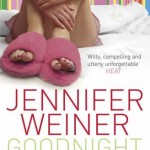 Les deux romans à notre programme ce mois-ci ont en commun leur thème – la « vie domestique » des femmes au foyer, pour reprendre la traduction d’Arlington Park ; on peut leur trouver un autre point commun : l’emploi de l’humour. Bien entendu, l’humour est beaucoup moins présent dans l’essai de V. Guéritault, qui s’attache à observer de manière neutre la situation psychologique et physique décrite dans nos deux romans.
Les deux romans à notre programme ce mois-ci ont en commun leur thème – la « vie domestique » des femmes au foyer, pour reprendre la traduction d’Arlington Park ; on peut leur trouver un autre point commun : l’emploi de l’humour. Bien entendu, l’humour est beaucoup moins présent dans l’essai de V. Guéritault, qui s’attache à observer de manière neutre la situation psychologique et physique décrite dans nos deux romans.
Si dans le cas de Jennifer Weiner, l’humour est mis en avant comme un argument de vente (cf la couverture de l’édition Pocket Books et la quatrième de couverture, qui qualifie l’ouvrage de « laugh-out-loud funny »), ce n’est a priori pas le trait stylistique le plus frappant d’Arlington Park.
Weiner utilise un humour très explicite, basé sur l’autodérision et la comparaison systématique de son héroïne aux canons véhiculés par les médias (et par ses voisines) sur la mère parfaite (à Upchurch) et la femme parfaite (à New York), au désavantage de celle-ci. Cela rapproche Kate Klein de Bridget Jones – laquelle n’a jamais été croquée dans sa vie de mère, Helen Fielding ayant choisi de passer directement des premières années de mariage aux premières années de veuvage.
Cusk, quant à elle, fait parfois preuve d’une ironie mordante, dont on ne sait s’il faut en rire ou en pleurer. Par exemple dans le chapitre consacré à Solly :
« Vraiment, Martin était merveilleux. Il était ce qu’on appelait un père présent. Le problème est qu’il n’était jamais là. » (p.149).
Ou encore, dans le chapitre sur le parc :
« Richard n’arrête pas d’aller à ces conférences où personne n’a l’air de savoir ce dont il est question. Je lui dis, tu sais, mais qu’est-ce que tu fais exactement ? Qu’est-ce que tu accomplis en réalité ? Je crois qu’ils vont se bourrer au bar de l’hôtel. – Eh bien, pourquoi pas, après tout. – Oui. C’est quand même un peu fou. Même Richard reconnaît que c’est un peu fou. » (p.166).
Ou enfin, dans le chapitre sur le club littéraire, lorsqu’une participante demande à Juliet pourquoi elle a coupé ses cheveux :
« C’est ce qui arrive quand on a mon âge. On en a soudain assez. (….) – Et alors on commence à faire des choses à ses cheveux, dit Sara avec tant de mépris qu’elle semblait, en fait, bien connaître le phénomène. Ou on se fait faire de la chirurgie esthétique. Et on commence à être obsédé par son intérieur, on interdit tout à tout le monde pour ne rien déranger. On est, genre, vous savez, pourquoi manger ? ça fait désordre. Pourquoi sont-ils obligés de changer de vêtements ? Pourquoi est-ce qu’ils ne portent pas juste une sorte de costume en plastique ? Pourquoi est-ce qu’il faut qu’ils rentrent à la maison ? Pourquoi est-ce qu’ils ne vont pas à l’hôtel? » (p. 186).
A l’inverse, l’humour de Goodnight Nobody est parfois un peu forcé, comme lorsque Kate chante « If you happy and you know it clap your hand » pendant l’hommage rendue à sa voisine assassinée : Kate se ridiculise, cela est censé nous faire nous sentir plus proches d’elle que des canons qui nous sont imposés et qui sont inatteignables. La manière dont Jennifer Weiner s’adresse ici à ses lectrices me fait penser à cette camelot rencontrée par les femmes d’Arlington Park dans le supermarché qui force la complicité avec son public en répétant « vous voyez bien ce que je veux dire » à propos de ses hanches trop fortes, alors qu’elles ne le sont pas réellement.
Si la lecture de Goodbye Nobody m’a été plutôt agréable, je n’ai pas pu m’empêcher de me sentir un peu prise au piège d’une connivence malsaine : l’auteur ne cherche pas à critiquer réellement les faux modèles occidentaux de la « Good mother », mais à dédramatiser le fait de ne pas réussir à les suivre. L’entreprise de démystification, notamment pas l’humour, me semble plus réussie dans Arlington Park, car s’y ajoutent des descriptions de la vie suburbaine contemporaine sidérantes d’ironie, alors même qu’elles sont implacablement factuelles (cf la description du supermarché et celle du parc).
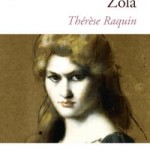 Thérèse Desqueyroux se désintéresse des tâches domestiques attribuées, dans son milieu, aux femmes (le soin des enfants vient au premier rang, mais aussi le soin du mari) quand sa belle-soeur Anne y excelle. La vie qu’elle mènera à Paris sera d’ailleurs une vie de célibataire, quasi-recluse, marginale.
Thérèse Desqueyroux se désintéresse des tâches domestiques attribuées, dans son milieu, aux femmes (le soin des enfants vient au premier rang, mais aussi le soin du mari) quand sa belle-soeur Anne y excelle. La vie qu’elle mènera à Paris sera d’ailleurs une vie de célibataire, quasi-recluse, marginale.